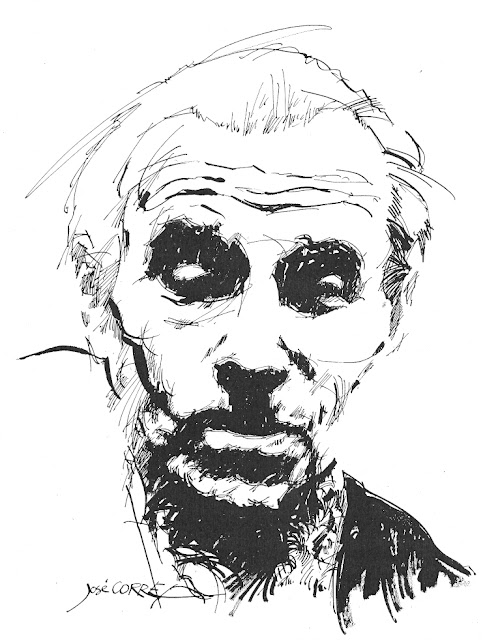Le mouvement Transitions, « groupe de recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 » publie sur son site internet, www.mouvement-transitions.fr, un texte de Bruno Chaouat, « Céline, fossoyeur des lettres ? », dialogue fictif soulevant la problématique de l'esthétique célinienne. C'est ce texte que nous reproduisons ci-dessous. Bruno Chaouat est Professeur associé de littérature française moderne et contemporaine à l’Université du Minnesota (USA), il a publié Je meurs par morceaux, Chateaubriand (Presses Universitaires du Septentrion, 1999), et L'Ombre pour la proie : Petites apocalypses de la vie quotidienne (Presses Universitaires du Septentrion, 2012). Il travaille à une histoire de la mémoire de la Shoah dans la théorie littéraire et la littérature françaises, des années soixante aux débats contemporains : Le Vif saisit le mort : les testaments trahis de la Shoah.
« Céline, fossoyeur des lettres ? »
par Bruno CHAOUAT
A. De qui vous jouez-vous ?
B. Je n’ai jamais été aussi sérieux, au contraire. Je tiens à revenir sur le cas Céline, et, à partir de ce cas particulier, sur la question plus vaste du beau en littérature, dans cet art qu’on appelait jadis les litterae humaniores, inséparables des humanités et de l’humanisme, de ce qu’on peut nommer la culture humaniste. Je retiens, pour celle-ci, j’aurai l’occasion d’y revenir, le sens de détour ou de médiation.
A. Vous ne pouvez cependant ignorer que tout a été dit. Le cas Céline est saturé. On en a, pour ainsi dire, fait le tour. On ne peut plus revenir sur l’affaire Céline, sur la question Céline. Bref, vous allez vous ridiculiser, soit en enfonçant des portes ouvertes, soit en vous imaginant, Don Quichotte de la critique littéraire, original. Et puis, pardonnez-moi, mais votre titre sonne comme une provocation ou une plaisanterie de potache… Céline, fossoyeur des lettres ? Lui qui a réinventé le roman ? Céline, si je lis bien vos insinuations, si je vous lis entre les lignes, serait un écrivain de l’immédiat, voire, pire encore, ou plus risible, un suppôt du discours dominant ? Lui, ce nouveau Malherbe qui vingt fois sur le métier… ? Rappelez-vous que, parodiant Boileau, il s’ancrait lui-même, certes paradoxalement et peut-être parodiquement, dans le classicisme français, dixit son Professeur Y, dans les Entretiens éponymes : « …vous, le plus grand écrivain du siècle, l’inventeur du style que vous dites, le Bouleverseur des Lettres Françaises... le Malherbe actuel en somme ! enfin Céline vint, c’est bien ça ? »[1]. Par ailleurs, Marcel Hénaff nous invite à comprendre la beauté, ou la grâce moderne, « comme une énergie — une vibration, une intensité — qui circule entre les choses mêmes, qui invite à en capter les écarts et à inventer des formes neuves et qui, soudainement parfois, donne à la vie — au cœur du monde ordinaire — une chance que l’on n’attendait pas. » Cette manière d’aborder la beauté, ou la grâce, dont je tiens les noms pour interchangeables, en ce contexte, dans un univers industriel et postindustriel, dans un « monde cassé » (Levinas), où règne l’expérience mutilée ou détruite (Adorno, Agamben), me paraît à même de cerner l’entreprise célinienne.
B. Une question est-elle jamais résolue ? Je ne le crois pas. Toute question est une blessure jamais suturée. L’originalité ? Je ne nie pas qu’elle soit, en ces parages, plutôt rare. Mais peut-être, aussi bien, est-ce une valeur surestimée… En outre, ce n’est pas moi qui vous apprendrai que la lecture est infinie, qu’il n’y a pas de dernier mot. Roland Barthes parlait, je crois, de la « spirale du sens ». La forme du dialogue, la vieille dialectique, me paraît à la mesure de cette spirale, qui exige un art de l’ironie. Enfin, en ce qui concerne l’humanisme, rappelez-vous que Céline dédia le premier volume de Féerie aux animaux. Au chat Bébert, aux chiens, aux oiseaux qui traversent son œuvre de leurs stridents pépiements[2] ? Je ne sais… Difficile, en tout cas, d’être plus clair dans la volonté de rupture avec l’espèce humaine. Céline fut un misanthrope métaphysique, un écrivain et un pamphlétaire post-humaniste, voire antihumaniste… Au demeurant, c’est en 1987 que Levinas, puisque vous l’évoquiez, le tiendra pour l’initiateur du mouvement de la littérature antihumaniste[3]. Levinas savait de quoi il parlait, d’autant plus que dès 1935, il avait fait l’éloge du Voyage.
A. Ne tronquez pas les textes : c’est de fort mauvais augure pour la suite de notre conversation. La dédicace à laquelle vous faites allusion est la suivante : « Aux animaux, aux malades et aux prisonniers ». C’est-à-dire aux sans voix. Est-ce là votre antihumaniste ? Céline, depuis le Voyage, comme Genet un peu plus tard, fait parler ceux-là mêmes que nul ne veut entendre. Est-ce là ce que vous appelez professer la haine de l’humanité ? Faut-il, par ailleurs, être humaniste pour être un grand écrivain ? La littérature et l’art se rient de votre piété et plus encore du puritanisme esthétique de Levinas, dont l’éthique masochiste se méfiait du plaisir littéraire et artistique, la fiction ressortissant pour lui à la totalité et à l’idolâtrie plutôt qu’à l’infini et à l’altérité du visage.
B. Levinas non seulement était nourri de littérature, des Russes du XIXème à la modernité française (Zola, Rimbaud, Huysmans, Maupassant, entre autres), mais il a également enrichi l’histoire du désamour entre philosophie et littérature de mémorables chapitres. Blanchot, Baudelaire, Shakespeare, Agnon, pour ne citer que quelques écrivains avec lesquels le philosophe que vous réputez hostile aux lettres s’est entretenu.
A. Admettons. Quoi qu’il en soit, toute œuvre est décentrement, défamiliarisation ; par ailleurs, je tiens que toute création témoigne de l’inhumain. L’homme n’est pas au centre de l’œuvre. Relisez Blanchot, justement. Toute œuvre est traversée par le dehors, et ce dehors peut s’appeler l’inhumain, ou bien encore… « les animaux ». Je vous trouve, en outre, un rien prétentieux, de vouloir éclairer un débat obsolète. Tout n’a-t-il pas été dit ? Permettez-moi de retracer, en quelques lignes, l’histoire des poncifs, paradoxes et autres apories de la critique célinienne : Céline, polisseur du langage, inventeur du parlécrit, génie, méchant homme et grand poète, pourfendeur de l’académisme littéraire… Céline, rénovateur des lettres et de la langue française, tout à la fois classique et moderne. De lui-même, Céline disait qu’il avait été « pléiadé vif ». La formule qui scelle son entrée au Panthéon des lettres françaises fut une boutade iconoclaste. Il s’agit toujours, pour Céline, de faire la nique à la tradition. Coquetterie de vieillard ? Toujours est-il que flatté par la reconnaissance de l’académie, il ne put la célébrer, inhibé qu’il était par l’idéologie esthétique du modernisme. L’œuvre télescope le moderne et le classique, et ce télescopage résume le phénomène Céline, sa primultimité, son émergence dans la littérature comme fin et commencement, comme chant du cygne, dont la légende veut qu’il se taise toute sa vie pour bien chanter une seule fois. Je suis le premier écrivain, et le dernier. Le dernier des premiers. Mort- né. Pléiadé vif. C’est tout lui.
B. Résumé percutant et non dénué d’esprit, qui ne tient cependant pas compte de tant d’autres voies frayées par la critique (poétique, psychanalytique, anthropologique, thématique, empathique mimétique, historico-politique, biographique, pour n’en citer que quelques-unes). Mais passons. Je ne vais pas résumer, en universitaire pédant, quatre-vingts ans d’histoire de la critique célinienne. J’enchaîne sur une piste : le dernier des premiers, fin et commencement, dites-vous. J’aime beaucoup votre formule, et je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’un poncif… Vous êtes trop modeste ! Céline, telle est, précisément, mon hypothèse, est un aérolithe, un hapax, comme disent les grammairiens ; il ne fait guère partie de l’histoire de la littérature, il s’en est exclu lui-même. Mais il y a plus : non seulement il s’est exclu de la République des Lettres, mais il a tenu à y mettre un terme définitif, à frapper d’obsolescence tout ce qui, dans les lettres, le précède et lui succède. Céline, vous allez bondir, met au tombeau les lettres françaises. C’est pourquoi j’aime à l’imaginer en fossoyeur. Vous souriez…
A. Vous ne trouvez donc pas que la littérature après Céline se porte bien ?
B. Certes, mais la mort dont je parle ici n’est que le désir de Céline, son wishful thinking. Si Céline n’a pu mettre fin à la grande tradition littéraire, cette fin, il l’aura néanmoins bruyamment désirée.
A. Céline avait l’oreille trop sensible pour que son désir fût bruyant…
B. Je trouve au contraire peu convaincantes les remarques de Milan Kundera sur la prétendue discrétion de Céline : Céline, qui visait la grâce et la délicatesse, le silence, peut-être, je vous l’accorde, a cependant fini lourdement et bruyamment ; il a fini avec laideur, au rebours du chien de Céline qu’évoque Kundera dans son hommage, qui meurt, contrairement aux hommes, sans « tralala »[4]. Céline, tout l’œuvre d’après-guerre me paraît l’attester, sombra dans une rumination narcissique et victimaire, rongé de ressentiment, dévoré par l’amertume ; tout le contraire d’un Blanchot, ou d’un Kafka, que j’imagine, Kafka, mourant comme son artiste de la faim, s’étiolant comme la voix de fin silence de sa cantatrice Joséphine. Me revient, au rebours de ces fins évanescentes, pour qualifier les œuvres d’après-guerre de Céline, certaines d’entre elles, du moins, et par exemple Maudits soupirs pour une autre fois, une phrase de L’Espèce humaine, de Robert Antelme, qui, de retour des camps, décrit en ces termes la déréliction du langage dans l’univers concentrationnaire : « l’enfer ça doit être ça, le lieu où tout ce qui se dit, tout ce qui s’exprime est vomi à égalité comme dans un dégueulis d’ivrogne. »[5] C’est Hélène Merlin-Kajman qui, dans La langue est-elle fasciste ?[6], me souffle ce rapprochement… A lire le dernier Céline, je cherche en vain l’écart à l’équilibre, le clinamen, où je ne rencontre qu’entropie poétique. Mais revenons à notre sujet : Céline aura donc souhaité enterrer, disais-je, la grande tradition littéraire. Il existe une véritable tentation de cette mise à mort de la tradition (appelez cela la table rase, la révolution : avant moi, rien, après moi, le déluge). Cette décapitation de toutes les autorités, de tous les auteurs, de tous ces autres qui font de l’ombre, ressortit à l’idéologie avant-gardiste. Mieux, et peut-être plus grave, Céline mit un point d’honneur à verrouiller l’avenir de la littérature. Votre sourire persiste, derrière lequel je vois poindre un commencement d’irritation…
A. Je vous retrouve bien là, avec votre goût du paradoxe et de l’hyperbole… Céline ne fait pas partie de l’histoire de la littérature, il en verrouille l’avenir, il met les lettres françaises au tombeau… Qu’entendez-vous prouver par ces formules grandiloquentes et dogmatiques ? Quant à L’Espèce humaine et au « dégueulis d’ivrogne », je vous laisse la responsabilité de votre indignation bien-pensante et de votre reductio ad Hitlerum… Vous me pardonnerez de voir un coup bas dans cette association farfelue entre Céline et Streicher ou un vulgaire kapo : c’est vous qui verrouillez le dialogue en recourant à ce type d’analogie. Mais revenons au rapport de Céline aux grands autres : il ne vous suffit pas qu’il se réclamât de Chateaubriand, dédiât le second volume de Féerie pour une autre fois à Pline l’Ancien, admirât Mme de Sévigné (qu’il trouvait « bandante », comme le rappelle Sollers qui ne manque pas une occasion d’être grivois) ? Qu’il s’inscrivît dans une lignée littéraire classique et vénérable, celle d’un Voltaire, d’un Pascal, d’un Villon, d’un Saint-Simon, d’un Rabelais, d’un La Fontaine ou d’un La Bruyère, cela compte-t-il pour rien ? Sollers encore : « Et que dit-il de ces écrivains ? Qu’ils ont un ‘goût qui reste’… Il va même beaucoup plus loin, puisqu’il dit qu’ils ont une ‘couleur absolue’. »[7] La « couleur absolue », c’est, me semble-t-il, l’idiome, le style en tant qu’il sépare (c’est le sens du mot « absolu »), en tant qu’il est intraitable. C’est dire que pour Céline, tout grand écrivain est le premier et le dernier, absolu, séparé, unique en son genre, phénix, hors généalogie…
B. Quel pathos ! Ecoutez, je ne fais que prendre Céline à la lettre, vous le verrez dans un instant. Mais puisque vous l’avez évoqué, permettez-moi de m’arrêter sur la compilation que Sollers a récemment publiée. Deux lignes après celles que vous venez de citer, Sollers ajoute cette formule de Stendhal : « Le mauvais goût conduit au crime ». Cela, voyez-vous, me laisse songeur : Sollers nous invite à penser, par Stendhal interposé, que c’est par faute de goût que Céline aura été antisémite. Céline se serait oublié dans ses pamphlets, aurait trahi son amour de la beauté, de la grâce, de la légèreté. C’est la fameuse thèse de la discontinuité, de la rupture, contre quoi, au moins, Henri Godard eut le mérite de s’élever (je pense notamment à son Céline scandale[8], où Godard s’était efforcé de penser ensemble antisémitisme et littérature, il n’est évidemment pas le seul à l’avoir fait ; je rappelle le chapitre important d’une universitaire américaine, Alice Y. Kaplan, sur le lien structurel entre littérature et antisémitisme, Reproductions of Banality [9], et puis, bien sûr, le livre classique de Julia Kristeva sur les Pouvoirs de l’horreur [10]). Mais pour Sollers, tout est simple : Féérie, Entretiens avec le professeur Y, Voyage, Mort à crédit, Guignol’s Band, etc., c’est l’innocence du bon goût, mieux, l’innocence de « l’enfant dans un monde coupable » (Sollers toujours), et mieux encore : la candeur du rire, la rédemption par le rire. Comme si la beauté n’était jamais criminelle, comme si le beau était toujours innocent, le rire, enfin, par-delà bien et mal. Les pamphlets, qui sont, eux de fort mauvais goût, Sollers semble le concéder implicitement, seraient du côté du crime. Avouez qu’il y a de quoi sourire de la désarmante naïveté de telles remarques émanant d’un lecteur chevronné, d’autant qu’elles datent de 2009, et qu’on serait en droit d’attendre à la fois davantage de rigueur et un peu moins de candeur aujourd’hui, que du temps qu’André Gide écrivait qu’il ne fallait guère prendre les pamphlets au sérieux.
 |
| Illustration de Loïk Rocques |
A. Ah ! Non, vous n’allez pas nous refaire le coup de l’antisémitisme ! C’est vous qui creusez votre tombe, fossoyeur de vous-même… Vous rendez-vous compte, là encore, que tout a été dit sur l’antisémitisme de Céline ?
B. En effet, vous le voyez, je ne crains guère le ridicule. « Sois pécheur et pèche énergiquement », exhortait Martin Luther. J’assume cette énergie peccamineuse… Céline, pense-t-on assez spontanément, aurait voulu préserver la pureté des lettres, de l’identité française, de la race nordique, aryenne, contre les Juifs, « youtres » « semi-nègres », etc. Sa haine des Juifs ressortirait à un fantasme de pureté, les Juifs auraient infiltré la littérature de l’extérieur, comme un virus, etc. On connaît les topoi de l’antisémitisme raciste, qu’il est inutile d’égrener. Ce serait faire preuve d’une grande mauvaise foi que de sous-estimer la rhétorique de la race dans les pamphlets. Je gage, pourtant, et à titre d’hypothèse paradoxale (vous savez mon inclination pour le paradoxe), que nous devons renverser cette interprétation : si Céline détestait les Juifs et voulait en purger la littérature française, c’est parce qu’il détestait les lettres et leur pureté, la pureté de la littérature (et je vous prie d’entendre « détester » dans le sens originel, profond, comme refus d’héritage). N’oubliez pas que Céline, cela vous surprendra peut-être, en 1937, vouait aux gémonies les « Juifs racistes » (la juxtaposition de « juifs » et de « racistes » revient à une fréquence troublante dans Bagatelles ; certes, il s’agit d’une projection, mais on peut également lire cela comme une forme là encore paradoxale d’antiracisme antijuif). Son antisémitisme, en effet, ne saurait être imputable au seul racisme, mais à une haine de ce qui se veut séparé, distinct (les Juifs comme nation emblématique de la séparation). Comment s’expliquer, autrement, qu’il se crût obligé de judaïser les plus grands écrivains de la tradition — Racine, « ce demi-quart-juif », par exemple, ce qui faisait rire Gide, et aujourd’hui Sollers, alors que je prends cela très au sérieux ? Car l’antisémitisme, chez lui, fut le corollaire de la haine des lettres.
A. Vous voulez dire que détester les lettres et détester les Juifs, c’est tout un ?
B. C’est à peu près cela. Les deux haines, pour ainsi dire, sont parentes, Juifs et belles-lettres communiant dans ce qu’il faudrait appeler une pureté inauthentique, une pureté artificielle, une pureté qui relève du simulacre, de l’imitation, c’est-à-dire de l’Ecole. J’ajouterai que l’antisémitisme est au cœur de la question littéraire pour Céline, de même que les Juifs (le Bien, la Loi), Eric Marty l’a montré[11], furent au cœur de l’expérience poétique et métaphysique de Jean Genet. Mais cette détestation, là est toute la difficulté, doit s’entendre comme geste de refondation. Il s’agit de se débarrasser d’un héritage (les « Juifs », les belles-lettres, l’Ecole) pour s’ériger soi-même en origine de la littérature. C’est donc par amour de la littérature, mais d’une littérature imaginée, là encore, comme absolue, comme expression d’une radicalité esthétique, que Céline rejette la tradition littéraire. Car c’est hériter qu’il refuse, et les Juifs, ou « les juifs », comme l’écrivait Jean-François Lyotard (on le lui a assez reproché, injustement je crois), et comme je trouve utile de les écrire ici pour la raison évidente qu’il ne s’agit pas des Juifs réels mais des Juifs inventés par Céline, incarnent un legs qui révulse l’antisémite. Ainsi, la violence des pamphlets est tout autant violence contre la langue et la littérature dite académique, que contre les Juifs, lesquels, pour la première fois dans la tradition de l’antisémitisme, notamment dans le contexte de l’antisémitisme racial de l’époque, se voient rejetés du côté de l’académisme et d’une certaine pureté de la langue et des lettres. Il faudrait évidemment dialectiser, distinguer de manière plus fine, montrer que cette pureté est l’impureté même ou l’inauthentique, tandis que l’impureté recherchée par Céline, à travers le parlécrit, est une nouvelle forme de pureté ou d’authenticité, à laquelle les Juifs non seulement n’ont pas accès, mais à laquelle ils font obstacle (puisque, vous le savez, les Juifs sont, dans les pamphlets, les rabat-joie, les empêcheurs de jouir). Pour le dire de manière plus abrupte, et pour vous donner le plaisir de m’accuser derechef de reductio ad Hitlerum : judaïser les lettres françaises, c’est appeler à la solution finale de la littérature.
A. Plus d’autres, tel serait, donc, selon vous, le rêve de Céline : en finir avec tout ce qui, en littérature, n’est pas lui. Plus d’auteurs, ni prédécesseurs, ni contemporains, ni successeurs ? La littérature, pour Céline, comme extermination symbolique de l’autre et assassinat des belles-lettres ?
B. Je n’invente rien : voici, dans les Entretiens avec le professeur Y, alias le colonel Réséda, ces Entretiens qui, vous en conviendrez, renferment son art poétique : « … mon style ‘rendu émotif’... revenons à mon style ! pour être qu’une petite trouvaille, je vous l’ai dit, c’est entendu, ébranle quand même le Roman d’une façon qu’il s’en relèvera pas ! le Roman existe plus ! … les autres existent plus ! les autres romanciers !... tous ceux qu’ont pas encore appris à écrire en ‘style émotif’... »[12] Et, un peu plus loin : « … tous les autres écrivains sont morts !... et ils s’en doutent pas !... ils pourrissent à la surface, enbandelés dans leurs chromos ! momies !... momies tous !... »[13].
A. Vous prenez à la lettre le manège de Céline, son Grand-Guignol, son « Sarabbath », comme il dirait. Vous faites grand cas de ce qui n’est, au fond, rien de plus qu’un appel au renouvellement d’une littérature que dans les années cinquante Céline juge sclérosée et moribonde. Un manifeste pour une littérature nouvelle…
B. Je n’en crois rien. Pareille violence me paraît inédite dans l’histoire des lettres (je parle moins des polémiques qui déchirèrent l’histoire de la République des Lettres –– République qui ne brilla pas toujours par sa civilité –– que des arts poétiques) ; il vous suffit de comparer à L’Ere du soupçon de Nathalie Sarraute (exactement contemporain des Entretiens), ou, s’il vous chante de remonter plus haut dans l’histoire, au temps qu’on écrivait moins des manifestes que des professions de foi littéraires, à la Préface de Cromwell, ou au Roman expérimental de Zola, pour ne rien dire de Boileau ou du Bellay, pour vous rendre compte que l’on a affaire, chez Céline, à une opération chirurgicale, non seulement à une rupture, mais à une amputation. Céline, son écriture, son style, sa révolution, peuvent, doivent se lire comme un « attentat » ou un sabotage, un acte de terrorisme poétique à la mesure sans doute de la révolution surréaliste (à cet égard, le style des Entretiens est analogue au style du manifeste ; il est de l’ordre de la mobilisation politique) :
« le style au plus sensible des nerfs !
— C’est de l’attentat !
— Oui, je l’avoue ! »[14]
Et en effet, il s’agit de fausser, de saboter, de biseauter les rails d’un métro, car telle est l’image que Céline utilise, pour parler du train de son écriture, « l’écriture-métro », le « métro-émotif », l’embarquement de toute la surface dans le métro : « je les lui fausse ses rails au métro, moi ! j’avoue !... ses rails rigides !... je leur en fous un coup !... il en faut plus !... ses phrases bien filées... il en faut plus !... son style, nous dirons !... je les lui fausse d’une certaine façon, que les voyageurs sont dans le rêve... qu’ils s’aperçoivent pas... le charme, la magie, colonel ! » Il s’agit, enfin, d’une prise d’otages. Le lecteur-voyageur, une fois embarqué dans son métro aux rails biseautés, « profilés », ne peut échapper au style de Céline. Tout sens critique, toute prise de distance, toute médiation doivent être abolis, neutralisés. Toi, lecteur, dès lors que tu as décidé, à tes risques et périls, de me lire, ne te pose aucune question, laisse-toi porter, transporter par mon parlécrit à fleur de peau, comme si ton cerveau était investi par ma prose, pris en otage par le charme infernal, la magie hypnotique d’un style à nul autre pareil : « la violence aussi ! j’avoue !... tous les voyageurs enfournés, bouclés, double-tour !... tous dans ma rame émotive !... pas de chichis !... je tolère pas de chichis !... pas question qu’ils échappent !... non ! non ! »[15]. A quel prix, donc, la beauté de la prose célinienne, sa « petite musique », son refus du « chichi » ? Au prix de quel nécessaire, de quel total abandon de la capacité critique du lecteur, de sa volonté ? Tout se passe comme si le vœu secret de Céline était de pénétrer dans la tête du lecteur, de squatter son âme : « Quand on me lit tout bas, il faut avoir l’impression qu’on vous lit à vous le texte tout haut en pleine tête, dans votre propre tête, c’est un truc. »[16]. C’est seulement dans la tentative d’investir le cerveau du lecteur, de penser à sa place, « en pleine tête » et, pour ainsi dire, à tue-tête, dans cette exigence de passivité absolue, qu’on peut comprendre la volonté de rupture que Céline aura incarnée. Vous le voyez : la terreur dans les lettres, c’est lui.
A. Mais il ne fut guère le seul à faire de l’art un attentat et du crime une œuvre d’art ! Le XXe siècle fut celui de la littérature et de l’art comme manifeste, appel à la mobilisation, action plutôt que représentation, immédiateté plutôt que médiation. En un mot, l’avant-garde au XXe siècle se rêva en action directe. Songez, ironie de l’histoire eu égard à la haine que Céline lui vouait, à Sartre et aux mots de la prose comme arme révolutionnaire. Il y a, au XXe siècle, toute une métaphysique de l’immédiateté, de l’authenticité, du direct en art et en littérature. Quant aux Surréalistes, ils rêveront l’œuvre immédiate, l’attentat, le crime lui-même, le passage à l’acte : « L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule ». Lisez Jean Clair, sur ce sujet, et notamment son livre sur le surréalisme et les totalitarismes. Breton n’aura fait ainsi qu’adapter la parabole baudelairienne du mauvais vitrier : « Je m’approchai du balcon et je me saisis d’un petit pot de fleurs, et quand l’homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets ; et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d’un palais de cristal crevé par la foudre. »
B. Vous avez raison d’évoquer la beauté baudelairienne, cette jouissance convulsive dans le mal, le poème comme crime… Georges Bataille avait vu juste, qui définissait le mal comme immédiateté, jouissance de l’instant et du jeu, contre le travail et la durée. Mais Baudelaire, après Sade, coula son apologie du mal dans la prosodie et le mètre classiques. Tout le bizarre baudelairien émerge du contraste entre l’expérience du monde industriel et de l’avènement du capitalisme, d’une part, et la forme lyrique de l’autre. Chez Baudelaire, comme chez Sade, la syntaxe, ou le sonnet, temporisent, agissent comme détour et médiation, pour ainsi dire, pare-choc du réel. Entendons-nous bien, puisque nous avons abordé l’antisémitisme, cas extrême du mal et de sa banalité, au XXème siècle. Il me paraît superflu de revenir sur un fait acquis : l’esthétique n’est pas coextensive à l’éthique[17]. Combien d’écrivains, d’artistes, de penseurs ne furent pas moins grands d’être ignobles. Il n’est pas jusqu’au divin Marquis qui sût manier la prose comme peu d’écrivains. Style cristallin de Sade, langue diamantine, pour mieux abjurer le Créateur et sa création. Ignobles scénarii sadiens, mais grand style, étonnement persistant devant la phrase de Sade, car précisément, avec Sade, demeure un noyau indestructible : et ce noyau, c’est la prose littéraire, médiation d’un style, détour de la syntaxe, du phrasé. Seule demeure cette ultime obédience : le consentement à l’exigence de la langue. La seule norme infrangible, la Loi d’airain que le libertin s’interdit jusqu’au bout de transgresser : « la syntaxe, ou l’autre dans la langue »[18], pour le dire avec Renaud Camus. S’il y a une éthique de Sade, elle n’est pas à rechercher dans un dialogue pervers avec Kant (Lacan), mais dans le respect de la langue comme Loi, ce qui reste du Symbolique après que tout fut aboli, principe, autorité, altérité. C’est la langue française qui sauve Sade du nihilisme. Ou, pour le dire autrement : l’exigence de la langue, sa souveraineté, introduit le scrupule de l’ironie dans le nihilisme sadien, elle désintègre la monstruosité intégrale (Klossowski) et fait de Sade l’un des grands interlocuteurs de la tradition des lettres françaises. Céline, au contraire, va faire sauter, non seulement les limites imposées par la langue, mais la littérature elle-même. L’attentat contre la syntaxe, chez Céline, n’a rien d’un don consenti aux lettres. C’est un attentat contre la littérature.
A. Votre analyse est d’une naïveté confondante. Premier point : Céline rit, et vous êtes plus sérieux que le Pape ! Vous manquez l’humour de Céline, le second degré, vous qui vous vous prévalez de la spirale du sens. Deuxième point : la destruction de la langue, chez Céline, est reconstruction, déconstruction, si vous préférez. A vous entendre, Céline serait un Baader ou un Netchayev ! Mais l’attentat dont parle Céline, je doute même qu’on le puisse comparer à l’appel de Breton au passage à l’acte, cette tarte à la crème des ennemis de l’avant-garde, ni davantage au propos de Stockhausen sur les attentats du 11 septembre 2001, comme « la plus grande œuvre d’art jamais réalisée ». Il s’agit, chez Céline, d’un arasement, certes, mais pour l’édification de nouvelles cathédrales, de nouvelles tours de langage…
B. Le rire… l’humour, le second degré. Oui, combien de fois nous a-t-on enjoint de rire avec Céline, et exhorté à cesser de jouer les rabat-joie ? Sollers nous l’a assez martelé : ne pas rire en lisant Céline, c’est n’y rien comprendre, paraît-il. Il faudrait s’interroger sur la qualité de ce rire. Et puis, voilà bien une arme absolue de langage : qui sait la manier met les rieurs de son côté : si vous ne riez pas, c’est au fond que vous ne comprenez pas. Seul un vrai lecteur peut apprécier Céline, c’est-à-dire en rire, une fois qu’il se sera délesté de son esprit de sérieux, de son esprit de pesanteur…
A. Zarathoustra savait rire.

B. Quelle différence, pourtant, entre les rires de Céline (je ne nie pas qu’il m’ait fait rire) et de Zarathoustra ! Entre le grand rire affirmatif d’un Nietzsche et le rire de celui qui se peint en éternelle victime, en suicidé de la société… Rapprocher ces rires me paraît une incongruité herméneutique, un contresens. Pour le reste, c’est-à-dire pour ce qui est de votre analyse dialectique ou rédemptrice de la destruction comme déconstruction, je vous aurai prévenu : je prends Céline au pied de la lettre, au premier degré, si vous voulez. Je lis les Entretiens comme un art poétique. Et j’en infère ceci : que le style de Céline signe l’arrêt de mort non seulement de la littérature contemporaine, mais aussi, et rétroactivement, de toute la tradition littéraire : « y a plus eu de nageurs ‘à la brasse’ une fois le crawl découvert !... »[19]. Le « style émotif » fossilise, momifie, rend caduc, frappe d’inanité tout ce qui précède. Quant à l’écrivain contemporain qui n’aurait pas pris acte de la révolution célinienne, le voilà déjà momifié, fossilisé, embaumé. La littérature non célinienne, non « émotive », est pourriture. A letter, a litter (Lacan). Et il s’agit bien, dans l’hybris narcissique de Céline, de muer tout ce qui n’est pas lui en déchet. « Toute écriture est de la cochonnerie », avait déclaré Artaud. Pour Céline, tout ce qui n’est pas mon écriture est de la cochonnerie. Ses héritiers ne sont que de vulgaires copistes. Ils font dans le kitsch, ou, comme il dit, dans « le chromo », le simulacre, la contrefaçon. Tout se passe donc comme si Céline avait saturé le style Céline, la manière célinienne, de façon à interdire toute prise de relève, tout passage de relais. De façon que personne, jamais, ne puisse se réclamer de lui, de façon, pardonnez-moi d’y insister, à verrouiller l’histoire de la littérature. En effet, prendre acte de la révolution célinienne ne garantit en rien contre le « chromo », cette mort symbolique : « Quand la ‘façon émotive’ sera devenue ‘public’... c’est fatal !... que l’académie sera pleine de ‘grisby’... ça sera la fin de ‘l’émotion’... tous les travailleurs du ‘chromo’ vous feront des ‘portraits émotifs’ à cent louis le point !... »[20]
Origine et fin, donc. Alors pour le coup, oui, je ne trouve rien de mieux approprié que la formule latine « sui generis » pour rendre compte du phénomène Céline. Rappelez-vous, puisque nous en sommes à parler latin, la position de Céline contre la messe en latin, dans un entretien radiophonique avec Albert Zbinden[21]. Cette curieuse parole, cette étrange apologie de la messe en français, signifie que s’il s’obstine à parler latin, le christianisme est mort, et les églises ne tarderont pas à être désertées. Céline invite donc les Chrétiens (mais il s’agit d’une allégorie, car l’entretien porte sur le style, la littérature, et c’est des écrivains que parle Céline) à s’adapter, à se moderniser. Ainsi, de même qu’il faut faire du christianisme quelque chose qui parle à l’homme contemporain, de même faut-il moderniser les lettres.
A. Ce fut précisément le rêve de Céline, et pour le coup, il s’agit bien d’un poncif : transcrire la langue parlée, retrouver l’esprit (la vie, le souffle, le pneuma) de la langue.
B. En effet. Dès lors, la question que je me pose est la suivante : l’écrivain écrit-il jamais, a-t-il jamais écrit en langue vivante ? La grande tradition littéraire ne requiert-elle pas, précisément, qu’on écrive de langue morte ? Littérature est d’abord de la lettre. Or, avec Céline, la langue doit s’adresser directement au corps, à l’organique, elle doit provenir du corps et y revenir, dire l’affect de la manière la plus directe possible, sans médiation. Toucher au nerf, à fleur de peau. Et pour vous prouver que la détestation des Juifs ou des « Juifs » est affine de l’horreur du détour, de la littérature dans sa détermination académique et humaniste comme médiation, temporisation ou retard, permettez-moi de citer cet extrait de Bagatelles pour un massacre : « Les Juifs manquent désastreusement d’émotion directe, spontanée... Ils parlent au lieu d’éprouver... Ils raisonnent avant de sentir... Au strict, ils n’éprouvent rien... »[22] Dès lors, les pamphlets doivent se lire comme la préparation de l’art poétique d’après-guerre, qui devra s’écrire, pour des raisons liées à la censure, en scotomisant la question juive. Ce n’est pas nouveau, bien entendu, Sartre remarquera, dix ans après la publication de Bagatelles, que pour l’antisémite, le Juif ou le « Juif » se distingue par son incapacité congénitale au sentiment immédiat (Réflexions sur la question juive). A l’inspiration, le Juif tel que l’antisémite l’imagine préfère la transpiration. A l’affect, il préfère le concept. Or la métaphysique esthétique de Céline se fonde entièrement sur l’affect, sur l’intensité, sur le direct. Considérez encore cet extrait : « Croyez-moi j’ai fait souvent l’expérience. Notre belle littérature néo-classique, goncourtienne et proustophile n’est qu’un immense parterre de mufleries desséchées, une dune infinie d’osselets frétillants... et rien n’est plus difficile que de diriger, dominer, transposer la langue parlée, le langage émotif, le seul sincère, le langage usuel, en langue écrite, de le fixer sans le tuer... Essayez... Voici la terrible ‘technique’ où la plupart des écrivains s’effondrent, mille fois plus ardue que l’écriture dite ‘artiste’ ou ‘dépouillée’, ‘standard’ moulée, maniérée, que l’on apprend branleux en grammaire de l’école. Rictus, que l’on cite toujours, n’y réussissait pas toujours, loin de là ! Force lui était de recourir aux élisions, abréviations, apostrophes Tricheries ! Le maître du genre, c’est Villon, sans conteste. Montaigne, plein de prétentions à cet égard, écrit tout juste à l’opposé, en juif, semeur d’arabesques, presque du ‘France’ avant la lettre, du Pré-Proust... » Et enfin : « Je m’en allais circonlocutant, j’écrivais en juif, en bel esprit de nos jours à la mode... dialecticulant... elliptique, fragilement réticent, inerte, lycée, moulé, élégant comme toutes les belles merdes, les académies Francongourt et les fistures des Annales »[23]. Tout est dans ce passage : « les Juifs » incarnent la dialectique, l’ellipse ou l’euphémisation, l’Ecole (le « lycée »), l’académisme en général. « Les Juifs », à cet égard, en tant que défenseurs et illustrateurs de la langue française, gardiens de sa pureté, sont une déjection littéraire, suivant une paronomase aussi ignoble que transparente, « fisture des Annales ». Permettez-moi de suspendre ici, momentanément, un entretien que je souhaiterais infini et dont nous reprendrons le fil, ce qui n’est pas m’arroger le dernier mot : ce que Céline aura rejeté chez « les Juifs » est moins, si je puis me permettre de jouer sur les mots, l’errance que l’hérence. Céline fut, au fond, moins écrivain des déshérités que de la déshérence.
Bruno CHAOUAT
Transitions, 25 février 2012.
Notes
[1] Céline, Entretiens avec le professeur Y, Romans IV, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 533.
[2] Philippe Bonnefis, Le Rappel des oiseaux, Galilée, 1997.
[3] Emmanuel Lévinas, « Langage quotidien et rhétorique sans éloquence », Hors sujet, Fata Morgana, 1986.
[4] Milan Kundera, Une Rencontre, Gallimard, 2009.
[5] Robert Antelme, L’Espèce humaine, Gallimard, 1957, p. 148.
[6] Hélène Merlin-Kajman, La Langue est-elle fasciste ?, Le Seuil, 2003.
[7] Philippe Sollers, Céline, Ecriture, 2009, p. 105.
[8] Henri Godard, Céline scandale, Gallimard, 1998.
[9] Alice Y. Kaplan, Reproductions of Banality (University of Minnesota Press, 1986).
[10] Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Le Seuil, 1980.
[11] Eric Marty, Bref séjour à Jérusalem, Gallimard, 2003.
[12] Op. cit. Entretiens avec le professeur Y, p. 528.
[13] Ibid. p. 530.
[14] Ibid. p. 537.
[15] Ibid. p. 536.
[16] Cité par Sollers, Op. cit. Céline, p. 13.
[17] Jean-François Lyotard, La Chambre sourde : l’antiesthétique d’André Malraux, Galilée, 1998.
[18] Renaud Camus, Syntaxe ou l’autre dans la langue, P.O.L, 2004.
[19] Op. cit. Entretiens avec le professeur Y, p. 528.
[20] Ibid. p. 504.
[21] Romans II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard.
[22] Bagatelle pour un massacre, Denoël, 1937, p. 69.
[23] Ibid. p. 111.