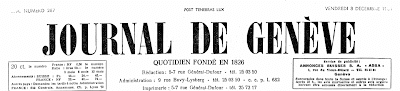Pour son quatrième entretien, Le Petit Célinien a donné la parole à Christophe Malavoy. Acteur, réalisateur, metteur en scène, écrivain, Christophe Malavoy travaille actuellement à la réalisation d'un long-métrage consacré à l'exode de Louis-Ferdinand Céline, ainsi qu'à une adaptation théâtrale des Entretiens avec le Professeur Y. Il est également l'auteur d'un ouvrage paru cette année, aux éditions Balland : Céline, même pas mort !.
Ce livre, qui a pour titre Céline, même pas mort !, est un véritable manifeste de votre part. Pourquoi avoir ressuscité l'auteur de Voyage au bout de la nuit l'année du cinquantième anniversaire de sa mort ?
Pour son quatrième entretien, Le Petit Célinien a donné la parole à Christophe Malavoy. Acteur, réalisateur, metteur en scène, écrivain, Christophe Malavoy travaille actuellement à la réalisation d'un long-métrage consacré à l'exode de Louis-Ferdinand Céline, ainsi qu'à une adaptation théâtrale des Entretiens avec le Professeur Y. Il est également l'auteur d'un ouvrage paru cette année, aux éditions Balland : Céline, même pas mort !.
Ce livre, qui a pour titre Céline, même pas mort !, est un véritable manifeste de votre part. Pourquoi avoir ressuscité l'auteur de Voyage au bout de la nuit l'année du cinquantième anniversaire de sa mort ?
Je ne l’ai pas ressuscité, pour la simple raison que Céline n’a pas besoin de moi ni de quiconque pour exister. C’est encore le plus lu des auteurs aujourd’hui. Anniversaire ou pas, Céline reste, qu’on le veuille ou non, l’auteur qui aura mis la littérature en mouvement et n’aura pas, comme il le dit très justement, laissé le temps à l’émotion de s’habiller en phrase. Je n’ai pas attendu le cinquantième anniversaire de sa mort pour écrire sur Céline. On n’écrit pas un livre sur Céline, comme ça, parce qu’on n’a pas d’autre chose à faire. Cela fait longtemps que je m’intéresse à Céline, et plus précisément quatre ans que je travaille sur un projet de long-métrage sur une partie de la vie de Céline, avec toutes les difficultés de mise en production que vous pouvez deviner. L’écriture du livre répond à une démarche de créer une dynamique pour favoriser la réalisation du film. Je ne pensais pas du tout écrire un livre sur Céline. Les choses se sont présentées comme ça. On croit décider de tout mais le plus souvent ce sont les évènements qui décident pour vous. On ne fait rien d’autre que de suivre ce qui a été décidé, parce que cette chose-là était tout naturellement déjà en vous.
Pour écrire ces entretiens, vous avez pris la liberté de mêler fiction et réalité. Quelles sont les raisons qui ont dicté un choix aussi téméraire ? D'une façon générale, quel accueil a reçu votre ouvrage ?
La seule raison qui vaille en littérature, c’est de prendre des libertés. C’est d’ailleurs ce que n’a pas cessé de faire Céline : Prendre des libertés. Que ce soit avec la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, la ponctuation, mais aussi le conformisme, l’académisme, le politiquement correct… Ce qui a dicté mon choix, c’est simplement de faire vivre Céline, de l’animer, de le sentir bouger, de ne pas en faire un cliché, une momie, de lui donner de la chair, du souffle, de la colère, de la tendresse, de faire entendre sa souffrance, sa poésie autant que ses excès… et surtout, de ne pas faire ce qui a déjà été fait. J’ai voulu un Céline vivant, loin des cercles et des salons, loin des commentaires, des explicââtions, de ceux qui ont des avis, des idées… j’ai voulu être le plus proche de Céline quand il dit «
j’ai pas d’idées moi ! aucune ! je trouve rien de plus vulgaire, de plus commun, de plus dégoûtant que les idées ! (
Entretiens avec le Professeur Y) Ce qui m’a dicté, c’est surtout une musique, la petite musique de la phrase, le ton juste… la vérité du « bouton de col à bascule. »
Quant à l’accueil que mon ouvrage a reçu, je n’en ai aucune idée. Mon éditeur ne m’a pas adressé un mot depuis la sortie du livre. Silence radio. Il est peut-être mort, je ne sais pas. Je ne lis pas les rubriques nécrologiques, je suis donc très mal informé. La seule chose que je sais, c’est que ceux qui lisent m’adressent parfois un petit mot via mon site internet [
www.christophemalavoy.com] et me disent le plaisir qu’ils ont eu à la lecture. C’est déjà beaucoup. Et je les en remercie…
Dans les toutes premières pages du livre, vous êtes pris à partie par un donneur de leçons qui n’a pas lu Céline. Ne pensez-vous pas que la personnalité peu avenante de l’écrivain soit un frein à l’envie de découvrir son œuvre ? Comment susciter le désir de lire Maudits soupirs pour une autre fois, ouvrage que vous considérez, « peut-être », comme le chef-d’œuvre de Céline ?
Ce que j’ai voulu dire en ouverture du livre, c’est que les « idées reçues » font plus facilement et même plus dangereusement leur chemin que l’opinion personnelle que chacun peut tirer de telle ou telle lecture. Il est assez surprenant de constater que tout le monde a un point de vue sur les pamphlets de Céline alors que très peu de gens les ont eus entre les mains, et par conséquent, les ont lus. Mais tout le monde s’accorde pour répéter ce que chacun a pu entendre dire, combien ils sont violents, abjects, nauséabonds… c’est en général les adjectifs que l’on entend. C’est cela que j’ai voulu mettre en relief et contre lequel je m’élève : condamner sans avoir vu, en l’occurrence sans avoir lu. Vous même, vous dites « la personnalité peu avenante de l’écrivain n’est-elle pas un frein à l’envie de découvrir son œuvre ? » C’est extraordinaire d’imaginer qu’il faudrait une personnalité avenante pour avoir envie d’aller vers un auteur et de le découvrir. Le pire des vices peut être un défaut en morale, pas en littérature. Vous imaginez le nombre d’auteurs qui ne seraient jamais lus ? Le meilleur de la littérature n’est que très rarement écrit par des gens « comme il faut », des gens « avenants » comme vous dites. Sade est-il un salaud ? Tolstoï est-il un salaud quand il écrit La sonate à Kreutzer ? Le plus violent pamphlet contre les femmes. Doit-on faire approuver sa façon de penser par la morale des autres ? « Ce n’est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, disait Sade, c’est celle des autres. » Savez-vous ce qui relie des auteurs aussi différents que le Marquis de Sade, Voltaire, Villon, Chénier, Chamfort, Chateaubriand, Victor Hugo, Vallès, Céline… la liste est longue… eh bien, c’est la prison et l’exil, et je ne parle pas de tous ceux qui ont eu maille à partir avec la justice comme Flaubert, Baudelaire et bien d’autres… La littérature a été portée par la folie, sinon par la maladie, avec des noms aussi illustres que Lautréamont, Proust, Kafka, Nietzsche, Céline… que cherche-t-on ? Des histoires d’amour qui finissent bien ?... Une morale bien bourgeoise qui sauvegarde les apparences et protège les atteintes aux mœurs ?... Vous me demandez comment susciter le désir de lire
Maudits soupirs pour une autre fois, il y a dans cette œuvre la féerie d’un Marc Chagall et les hallucinations d’un Goya ou d’un Jérôme Bosch. André Gide avait d’ailleurs, à mon sens, très bien résumé le style célinien. «
Ce n’est pas la réalité que peint Céline, disait-il,
mais l’hallucination que la réalité provoque. »
Maudits soupirs… est une première version de
Féerie pour une autre fois. Je la trouve personnellement supérieure.
Le lecteur pourrait vous reprocher une certaine mansuétude à l'égard des engagements idéologiques qui ternissent l'œuvre de Céline. N'avez-vous pas le sentiment, en développant une rhétorique que d'aucuns pourraient qualifier de spécieuse, d'être l'avocat du diable ? N'y a-t-il aucune provocation à faire dire à Céline : « Qui est responsable des charniers de Katyn et de Vinitzia ? » ou « A côté de Staline, Hitler était à l'époque un jeune puceau ! » ?
Je n’épargne pas l’hystérie antisémite de Céline ni ses furies antibourgeoises, anticommunistes, anticléricales, antimilitaristes… je tente de mettre en lumière toutes les contradictions du personnage et elles sont nombreuses. Je donne la parole aux faits et restitue ce qu’il a dit avant la guerre, bien avant l’extermination des Juifs par les nazis, mais aussi ce qu’il a pu dire après la guerre, comme par exemple ce propos sur l’antisémitisme qu’il confie en 1947 à un étudiant américain, Milton Hindus, lors d’un échange épistolaire qui sera réuni par ce dernier dans un livre L F Céline tel que je l’ai vu. Il dit ceci : «
Il n’y a plus d’antisémitisme possible, concevable – L’antisémitisme est mort d’une façon bien simple, physique si j’ose dire… il est temps de mettre un terme à l’antisémitisme par principe, par raison d’idiotie fondamentale, l’antisémitisme ne veut rien dire – on reviendra sans doute au racisme, mais plus tard et avec les juifs – et sans doute sous la direction des juifs si ils ne sont point trop avilis, abrutis – ou trop décimés dans les guerres. » Ce que les gens savent peu, c’est que Céline avait une véritable admiration pour les juifs, il appréciait leur intelligence, leur sens de la solidarité, leur côté messianique… paradoxalement, il a pu dire «
Vive les juifs bon Dieu ! » ou encore «
j’étais fait pour m’entendre avec les youtres ! ».
Je ne porte pas un jugement moral sur l’homme ni sur l’écrivain, mais je tente de comprendre la « tragédie » de Céline et comment la mort, la grande inspiratrice de toute son œuvre, va le conduire jusqu’au bout de la nuit. Je remets l’homme au cœur du contexte, au cœur de l’histoire sans laquelle on ne peut saisir les enjeux. Je ne pense pas qu’il y ait provocation à faire dire à Céline « À côté de Staline, Hitler était à l’époque un jeune puceau ! » ni même « Qui est responsable des charniers de Katyn et de Vinitzia ? » N’oubliez pas le contexte dans lequel je les fais dire à Céline. Si vous sortez ces phrases de leur contexte, elles peuvent apparaître comme vous dites provocantes, mais si vous les replacez dans le contexte, c’est autre chose… nous sommes en 1938, avant l’Holocauste, quand je fais dire à Céline «
…Et le danger à l’époque, c’était qui ? Hitler ou Staline ?... Qui a déporté durant la collectivisation des terres des millions de personnes dans les camps de travail du goulag en Sibérie ?... et qui les a fait crever d’épuisement et de faim ?... Qui a réalisé les Grandes Purges de 1937 ?... qui ont encore fait des milliers de morts et disparus ?... Qui a fait déporter intégralement toutes les minorités du pays ? Qui a sédentarisé par la force toutes les populations nomades d’Asie centrale ?... Qui a nié l’existence des famines de 1932 et 1933 qui ont fait encore des milliers de morts ?... Qui a créé la police politique ?... la redoutable Tcheka, véritable rouleau compresseur des libertés individuelles ?... Qui a créé les juridictions spéciales du NKVD qui décrétaient sans appel les sentences de mort ?... Qui est responsable des charniers de Katyn et de Vinitzia ? Des milliers d’officiers polonais abattus d’une balle dans la nuque ? Toute l’intelligentsia polonaise supprimée de la carte !... À côté de Staline, Hitler à l’époque était un jeune puceau ! il faut se remettre dans le contexte de l’époque, je le répète, je rabâche, je sais, je gâtouille !... j’ai le droit, je suis vieux !... C’est bien facile de juger l’Histoire une fois qu’elle a eu lieu ! C’est comme les trains, c’est plus facile de les regarder passer que de les faire partir à l’heure ! »
Voilà le contexte. Pardonnez la longueur de la citation mais elle me semble nécessaire pour éclairer le lecteur. On ne peut pas citer le point sans le contrepoint. C’est usurper le sens, et c’est un peu commode.
Je ne pense pas faire preuve de mansuétude à l’égard des engagements idéologiques de Céline, je tente de faire comprendre les enjeux et la complexité des évènements dans une période très tourmentée dans laquelle il n’était pas si facile de voir clair. Pour la majorité des Français, le danger venait de l’Est et du bolchevisme qu’ils craignaient de voir s’étendre jusqu’à Brest. Beaucoup voyait en Hitler un rempart contre le danger bolchevique. L’Histoire s’écrit toujours du côté des vainqueurs. Il faut se méfier des raccourcis et des idées reçues. Et quand on cite une phrase, toujours la remettre dans le contexte. C’est le devoir du journaliste comme de l’Historien. Vous connaissez l’aphorisme, « donnez-moi deux phrases de n’importe qui et je le ferai pendre ! ».
On a parfois le sentiment que « Ferdinand furieux » sert de porte-voix idéal pour esquinter, entre autres... la presse, les éditeurs, les hommes de lettres, le cinéma, la musique, la politique, la télévision, la publicité, la finance, le bonheur, l'humanité, l'école, la culture... N'est-il pas devenu commode de fulminer dans l’ombre de « l’homme en colère » ? Pensez-vous par ailleurs que « l'accomplissement de l'homme se fasse dans la résistance (...) » ?
Je n’ai pas le sentiment avec ce livre de me mettre dans l’ombre de « l’homme en colère ». Ecrire un livre sur Céline est un travail très délicat qui nécessite une connaissance de l’œuvre mais aussi de l’Histoire dans laquelle cette œuvre a vu le jour. Céline est un grand chroniqueur, comme il aimait d’ailleurs se définir lui-même, et à ce titre il avait une grande admiration pour des personnalités comme Jean de Joinville ou encore Philippe de Commynes. Mon travail sur la vie et l’œuvre de Céline m’ont conduit à en saisir la grande modernité, et de le mettre au cœur de la réalité d’aujourd’hui me semblait être intéressant pour mettre en relief sa contemporaénité. Que dirait-il de la presse, des éditeurs, des hommes de lettres, du cinéma, de la télévision, de la publicité, de la finance… il dirait, je pense, la même chose, et même pire, car l’homme n’a hélas pas changé, il est toujours aussi lourd, vulgaire, «
rampant, abruti, pénible de lenteur insistante »… c’est en cela que Céline est moderne, de toutes les époques, et ses colères sont encore aujourd’hui criantes de vérité… c’est cela que j’ai voulu mettre en avant. Je me sers bien sûr de Céline pour dire certaines choses comme Platon se servait de Socrate… Et cependant, même quand Céline parle de Houellebecq, de madame Bettencourt ou des moines de Tibérine, comme je le lui fait dire, c’est en partie le vrai Céline qui parle… ce sont ses mots parfois qui jaillissent… seuls les céliniens, bien sûr, peuvent reconnaître la phrase originale. À ce propos, il y en a un qui s’est fait prendre au piège. J’en suis vraiment désolé pour lui. C’est le critique du
Nouvel Observateur –
Nouvel Obs/ 9-06-11 - qui, après avoir dit que j’avais écrit n’importe quoi, et pour bien souligner sa connaissance de l’œuvre de Céline et surtout illustrer la médiocrité de mon livre, termine en ces termes : «
Imagine-t-on Céline dire : « Le monde est un théâtre, je ne suis plus de l’acte qui se joue. » Manque de chance, ce monsieur, qui ne connaît sans doute pas bien Céline - on ne peut pas bien sûr le lui reprocher – est tombé pile sur une des phrases de Céline lui-même, une phrase au demeurant très belle, mais ça, faut-il encore un peu de finesse et de goût pour s’en rendre compte. On ne peut pas non plus le lui reprocher. C’est toujours mieux de parler des choses que l’on connaît. Comme disait Coluche…
Quant à savoir si l’accomplissement de l’homme se fait dans la résistance, je pense que Céline en est un bel exemple. Sa vie entière fut bâtie sur la résistance… résistance au conformisme, à l’académisme, à l’ordre établi, à la pensée bourgeoise, «
bien butée et bien conne », à l’insignifiance, à la bêtise, à «
ce vague ronron d’optimisme, cet accompagnement de tisanes, ce chœur de niaiseries digestives », Céline n’a pas cessé de résister à l’idée reçue, aux stéréotypes, à la norme… mais aussi à la maladie, les migraines, les névralgies, les insomnies, les crises de palu, les vertiges, les déficiences biliaires, les maux intestinaux, les rhumatismes, la paralysie du bras et de la main… celle qui écrit… l’accomplissement de Céline, il est, comme disait Nietzsche, dans cette victoire sur la douleur par la Connaissance. La connaissance de l’homme et de l’art littéraire. Oui, comme l’art naît de la contrainte, je pense que l’homme s’accomplit dans la résistance. C’est le b.a ba de la psychanalyse.
A propos d'opposition, nous connaissons votre détermination à vouloir adapter Céline au cinéma, ainsi que les difficultés que vous rencontrez depuis plusieurs années (lire à ce sujet l'interview réalisée par David Alliot, dans le deuxième numéro du trimestriel Spécial Céline). Qu'en est-il de votre projet de jouer les Entretiens avec le Professeur Y au théâtre ? Qu’est-ce qui a motivé ce choix ? Que représente le Professeur Y ?
Je poursuis cette âpre tâche qui consiste à trouver un partenaire financier pour mettre mon projet de long-métrage en production. C’est un travail qui demande beaucoup d’énergie, de courage et d’humilité. Le soutien des frères Brizzi qui collaborent au film pour sa partie animation m’est précieux. Ce sont des artistes de grand talent qui croient beaucoup au projet et s’y investissent avec passion. J’espère sincèrement que le film pourra se faire avec les moyens qu’il mérite. Un film tourné en cinémascope et en 3 D. Une version 2D est à mon avis également à envisager. Ce serait une grande première dans l’histoire du cinéma. Jamais Céline n’a été porté à l’écran. Il serait étrange de pouvoir faire des films sur Hitler, Staline, Franco, Pinochet, Pol Pot, Amin Dada… et que Céline fût censuré.
Quant aux
Entretiens avec le Professeur Y, c’est un projet qui me tient à cœur pour sa dimension comique mais aussi pour son caractère très iconoclaste, son délire, et son anticonformisme. Céline s’y exprime très librement, avec beaucoup de fantaisie, et la confrontation avec le Professeur Y qui meurt de trouille et finit par faire dans son pantalon est un grand moment de comédie et de burlesque très jouissif. C’est aussi une mise en cause de la pensée unique, de la norme qui tuent nos sociétés standardisées.
Terminons cet entretien par une interrogation plus large. Céline affirmait : « Une langue c'est comme le reste, ça meurt tout le temps, ça doit mourir ». Pour le Bulletin célinien de juin 2011, Philippe Alméras répondait à la question posée par Marc Laudelout : « Pensez-vous, comme certains, qu'il pourrait devenir difficilement lisible par les nouvelles générations ? ». Réponse de l'intéressé : « Il lui arrivera sans doute ce qui est arrivé à Rabelais (qui, ne l'oublions pas, « a raté son coup ») : on apprendra le Céline pour lire Céline, comme on apprend le Rabelais pour lire Rabelais (...) ». En 2011, Christophe Malavoy écrit un livre qui a pour titre Céline, même pas mort ! Que restera-t-il de Céline et de son œuvre dans un siècle ?
J’ai le sentiment que la lumière de Céline nous parviendra encore dans un siècle, comme celles de Rabelais ou de Villon nous éclairent encore plusieurs siècles plus tard. Ce sont un peu comme des étoiles… Socrate, Platon, Epicure… sont toujours là. Que se passera-t-il dans un siècle ? Personne ne le sait, et pour cause… on peut citer Céline qui disait «
ils achèveront plus tard mes livres, beaucoup plus tard, quand je serai mort, pour étudier ce que furent les premiers séismes de la fin, et de la vacherie du tronc des hommes, et les explosions des fonds d’âme… ils savaient pas, ils sauront ! »
Mais peut-on savoir ce que la postérité retiendra ? Les hommes savent-ils jamais la vérité sur ce qui se passe ? En littérature comme en toute chose, il faut beaucoup d’humilité. Juger les gens est toujours hasardeux… c’est très idiot… la littérature n’est pas un concours. Quelle importance… et qui sera là pour vérifier ? Mon sentiment est que Céline n’a pas fini de faire couler de l’encre… lui qui ne rêvait que d’une seule chose : Qu’on lui foute la paix, ce qui n’est pas le cas.
Propos recueillis par Emeric CIAN-GRANGÉ
Le Petit Célinien, 14 novembre 2011.
> Téléchargez cet entretien (pdf)

Christophe Malavoy,
Céline, même pas mort !, Ed. Balland, 2011.
Commande possible sur
Amazon.fr.