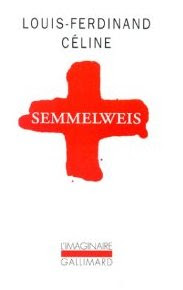Thèse médiocre ou roman prometteur ?
L.-F. Céline en historien de la médecine (1)
par Jérôme MEIZOZ
L’écrivain, quand il se fait
biographe, engage le plus souvent sa propre identité littéraire dans le
personnage qu’il raconte. Pensons à la Vie de Rancé (1844) de Chateaubriand ou plus près de nous aux rêveries biographiques de Pierre Michon sur Balzac ou Faulkner, dans Trois auteurs (1997). Cet article propose une lecture détaillée de la thèse de médecine de Louis Destouches (futur Louis-Ferdinand Céline) La Vie et l’œuvre de Philippe Ignace Semmelweis 1818-1865 (1924).
Recourant aux regards croisés de la sociologie de la culture et de
l’histoire littéraire, il s’agira de comprendre à quel acte énonciatif
prétend le Dr. Destouches puis de décrire les médiations éditoriales qui
transforment sa thèse de médecine en un récit littéraire, intégré
rapidement au corpus d’œuvres de L.-F. Céline.
En
effet, en 1924, le Dr. Destouches n’est pas un auteur de littérature,
c’est un simple médecin qui viendra à la littérature des années plus
tard. Dans cette étude, nous nous intéressons aux passages
institutionnels entre les discours de la sphère scientifique et ceux du
champ littéraire. Avec pour conclusion la porosité de ces univers, en
1924 du moins.
Nous voudrions
attirer l’attention sur trois questions au moins. Premièrement, nous
interrogerons les tensions qui régissent les rapports des discours
scientifiques (ici l’exercice académique de la thèse) et littéraire. En
effet, le devenir de cette thèse de médecine témoigne du désir d’un
auteur de textes médicaux à accéder au statut d’écrivain. Pourtant, on
le verra, l’accès à un tel statut n’est pas le fait du texte même, mais
tient aux déplacements de celui-ci de la sphère scientifique à celle des
lettres. Il est un phénomène d’« appropriation » culturelle (édition et
réception)(2).
Deuxièmement, on observera le rôle de ce travail réalisé au sein de la
communauté scientifique dans l’élaboration de l’œuvre future du
romancier.
Troisièmement enfin, nous saisirons comment une posture
littéraire se construit ici par identification, paradoxale, du discours
académique avec la parole déchue d’un découvreur maudit, le médecin
hongrois Philippe Ignace Semmelweis, à qui la médecine doit des
observations décisives sur la nécessité de l’asepsie en salle
d’accouchement.
Le Semmelweis et ses réélaborations éditoriales.
Louis Destouches, au bénéfice d’un baccalauréat abrégé pour anciens combattants, fait sa médecine et soutient sa thèse le 1er mai
1924. Durant toute sa carrière d’écrivain, cet ouvrage sera réédité, et
intégré à son œuvre. Suivons le statut éditorial étrange de cet
ouvrage, dont on peut résumer ainsi le périple :
— Dr. Louis Destouches, La Vie et l’œuvre de Philippe Ignace Semmelweis (1818-1865), thèse de médecine, Rennes, Francis-Simon imprimeur, décembre 1924. Une contraction paraît sous le titre « Les derniers jours de Semmelweis », La Presse médicale, no 51 du 25 juin 1924.
— [Louis Destouches, [titre inconnu], manuscrit refusé en juillet 1928 aux éditions de la NRF, Paris].
— Louis-Ferdinand Céline, Mea culpa suivi de La Vie et l’œuvre de Semmelweis, Paris, Denoël & Steele, décembre 1936.
— Louis-Ferdinand Céline, Semmelweis (1818-1865), Paris, Gallimard, 1952.
— Louis-Ferdinand Céline, La Vie et l’œuvre de Semmelweis (1818-1865), in Œuvres éditées par Jean À. Ducourneau, Paris, Balland, 1966, t. 1.
— Louis-Ferdinand Céline, La Vie et l’œuvre de Semmelweis (1818-1865), Cahiers Céline 3, Paris, Gallimard, 1977. Texte original annoté et préfacé par Henri Godard et Jean-Pierre Dauphin.
— Louis-Ferdinand Céline, Semmelweis,
Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1999. Texte original annoté de
l’édition de 1977, avec une préface de l’écrivain Philippe Sollers.
Soutenu comme thèse de médecine de la Faculté de Paris, La Vie et l’œuvre de Philippe Ignace Semmelweis (1818-1865) du
Dr. Louis Destouches est publié à compte d’auteur en décembre 1924 à
Rennes, mais nullement diffusé hors du cercle académique.(3)
Le sujet de cette thèse aurait été inspiré par le professeur Athanase
Follet, beau-père de Destouches et lui-même membre du jury : il
s’agissait de récapituler le parcours scientifique du médecin hongrois,
promoteur malheureux de l’asepsie. Semmelweis eut en effet l’intuition
des causes microbiennes de la fièvre puerpérale, mortelle jusqu’à la
révolution pasteurienne, mais il ne put faire reconnaître la pertinence
de son travail de son vivant et mourut prématurément, dans une grande
détresse. L’ouvrage de Destouches fait l’objet d’une contraction à
l’usage des pairs, « Les derniers jours de Semmelweis », dans La Presse médicale. L’auteur le propose en juillet 1928 aux éditions de la NRF qui le refusent. Le 28 décembre 1936, Denoël l’édite à peine retouché, sous le titre abrégé de La Vie et l’œuvre de Semmelweis, à la suite de Mea culpa.
Publié cette fois sous le nom de Louis-Ferdinand Céline, annexé et
désormais intégré à l’œuvre littéraire déjà reconnue, cet essai
biographique renforce la posture que Céline a imposée dès 1932 au
public, celle du médecin-qui-écrit. Réédité en 1952 par Gallimard dans
la collection blanche sous le titre encore abrégé de Semmelweis (1818-1865), il fait désormais pleinement partie de l’œuvre littéraire et se voit donc inclus dans les Œuvres préparées par Jean A. Ducourneau en 1966.(4)
En 1977, le troisième volume des « Cahiers Céline » en redonne le texte
et le titre original à l’usage des spécialistes, avec une annotation
d’Henri Godard et Jean-Pierre Dauphin. Enfin, le texte annoté de cette
édition accède en 1999 à la collection de poche « L’Imaginaire », sous
le titre désormais dépouillé de Semmelweis, avec une préface de l’écrivain Philippe Sollers. Rachetant soixante-dix ans plus tard le refus initial des éditions de la NRF,
celui-ci relit sur un mode littéraire « cette drôle de “ Thèse ” dans
le style épique » comme l’acte de naissance d’un écrivain (Jean
A. Ducourneau ne disait pas autre chose en 1966).(5)
Ultime
étape de la re-littérarisation d’une thèse de médecine : le corpus que
constitue « L’Imaginaire » et l’horizon de la collection donnent à lire Semmelweis comme
une œuvre à part entière de Céline, au même titre que ses romans.
Quatre éditeurs et six éditions, sous quatre titres différents, ont
parachevé sa mue bibliographique.(6)
On
l’a dit, très peu de retouches ont été apportées au détail du texte
académique de 1924 en vue de sa transfiguration littéraire dès octobre
1936. Céline n’a pas même corrigé les importantes rectifications
factuelles proposées dès 1925 par le professeur Györy, éditeur des Œuvres complètes de Semmelweis.(7)
Relevons toutefois trois modifications importantes dont l’impact
pragmatique semble majeur, et qui engagent une re-programmation de la
lecture. Premièrement, Céline supprime la préface de 1924, défense et
illustration de la corporation médicale, pour une nouvelle préface
nettement plus crépusculaire. Entre temps, dans l’incipit de Mort à crédit (mai 1936) le médecin Ferdinand annonçait la couleur : « Je n’ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde ».(8) Donner l’ouvrage à la suite du premier pamphlet antisémite et anticommuniste, Mea culpa,
invite à une lecture politique que confirme la préface de 1936. Ce
récit « nous démontre le danger de vouloir trop de bien aux hommes »
(« Préface » à l’édition de 1936, p. 15), argumentaire misanthrope selon
qui tout bienfaiteur de l’humanité est immédiatement voué aux gémonies.
Deuxièmement, Céline supprime l’épigraphe de Romain Rolland, « La Nuit
du Monde est illuminée de lumières divines » (p. 97). Discrètement, il
rejette celui qui fut, avec Barbusse, une de ses admirations pacifistes
dans les années 1920. Rolland s’est rapproché des communistes, et
l’énoncé cité promet un espoir historique auquel Céline n’adhère plus.
Troisièmement enfin, le sous-titre final « Conclusion » (p. 100) n’a
plus cours dans l’édition de 1936, atténuant ainsi la mise en forme
académique propre à l’exercice de thèse.
Thèse, éloge, hagiographie, légende ?
Le
public originel de la thèse de 1924 est académique et scientifique, et
l’exercice doit s’accorder aux règles de l’institution. Avec succès,
semble-t-il, puisque, malgré des examens universitaires laborieux,
Destouches obtient une médaille de bronze pour sa thèse le 22 janvier
1925. Le modèle générique sous-jacent s’adosse lui aussi à
l’institution : c’est l’éloge académique, genre factuel qui connut un
grand succès au 18e siècle et se pratique encore de nos jours dans les académies.(9)
Lors de cet exercice, le membre d’une académie récapitule en un exposé
biographique les mérites et découvertes d’un grand prédécesseur.
Fontenelle, par exemple, publia dès 1708 plus de soixante-neuf éloges de
savants, parmi lesquels Newton et Leibniz. Ce genre épidictique au
style élevé, solennel et sublime, répond à deux visées principales :
synthétiser les principaux acquis d’une pensée scientifique et les
inscrire dans la mémoire de l’institution. Tout aussi codé que l’éloge
funèbre, demeurant toutefois en deçà du panégyrique, l’éloge académique
recourt aux éléments biographiques pour affirmer la grandeur des idées
et leur insertion dans les circonstances d’une vie.
Au cœur de ce canevas générique et de son contrat factuel, deux procédés relèvent de la fiction :
d’abord, la narration dramatisée d’épisodes fictifs, comme celui des
affiches placardées en ville par un Semmelweis devenu fou (p. 93), ou la
scène de la blessure infligée durant la dissection (pp. 96-97). Dès
1925, en réponse à la contraction de la thèse parue dans La Presse médicale,
le professeur Tiberius de Györy avait pourtant déclaré ces épisodes
« de pure imagination » (p. 121). Mais en 1936, Céline se moque bien de
ces rectifications. La précision historique et scientifique ne semble
plus intéresser l’écrivain désormais reconnu dont l’ouvrage reparaît
chez Denoël : une visée littéraire a pris le dessus. Second procédé
d’ordre fictionnel, l’intertextualité hagiographique de La Vie et l’œuvre de Semmelweis. Bien
que chronologique, le récit ne propose pas l’exposé systématique d’un
parcours scientifique et de ses résultats, mais plutôt une mise en scène
dramatisée et téléologique de moments cruciaux où se révèle la valeur
exceptionnelle du médecin.
Le discours biographique comme exemplum postural.
Toutes
les caractéristiques et topiques du génie méconnu, telles que
l’historiographie les a identifiées depuis Edgar Zilsel (1926)(10),
sont rabattues, dans le commentaire, sur Semmelweis. Le « génie »
(p. 55) annonce des vérités qui tendent à le « rendre intolérable »
(p. 73). Il se manifeste « dans les grandes circonstances de ce monde,
quand le torrent des puissances matérielles et spirituelles, obscures,
mêlées, entraînent les hommes en foules hurlantes mais dociles, vers des
fins meurtrières » (p. 55). Conformément à la phobie des masses qui
hante l’imaginaire social des élites françaises, comme en témoigne
l’ouvrage de Gustave Le Bon (Psychologie des foules, 1895), c’est dans ces « foules » que surgit l’être d’exception :
« Bien
peu parmi les mieux doués, savent alors faire autre chose que de se
signaler par une course plus rapide vers l’abîme ou par un cri plus
strident que les autres. Rarissime est celui qui, se trouvant au milieu
de cette obsession des ambiances qu’on appelle la Fatalité, ose, et
trouve en lui la force qu’il faut pour affronter le destin commun qui
l’entraîne. » (p. 55)
Le
lexique de la prédestination s’inspire des propos de Semmelweis
lui-même cité (dans une libre traduction de Destouches ?) dans
l’ouvrage :
« Le destin m’a choisi pour être le missionnaire de la vérité quant aux mesures qu’on doit prendre pour éviter et combattre le fléau puerpéral. J’ai cessé depuis longtemps de répondre aux attaques dont je suis constamment l’objet ; l’ordre des choses doit prouver à mes adversaires que j’avais entièrement raison sans qu’il soit nécessaire que je participe à des polémiques qui ne peuvent désormais servir en rien aux progrès de la vérité. » (pp. 55-56)
Le biographe en tire des conclusions générales sur la place de la raison dans l’histoire :
« Mais, décidément, la Raison n’est qu’une toute petite force universelle, car il ne faudra pas moins de quarante ans pour que les meilleurs esprits admettent et appliquent enfin la découverte de Semmelweis. » (p. 73)
« Enfin, Semmelweis puisait son existence à des sources trop généreuses pour être bien compris par les autres hommes. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu’elle a de plus simple et de plus beau : vivre. Il l’aima plus que de raison. Dans l’Histoire des temps, la vie n’est qu’une ivresse, la Vérité c’est la Mort. » (p. 38)
Cette profession de foi nihiliste posée dès 1924 fait retour dans Voyage au bout de la nuit (1932) en une formule très proche :
« La vérité de ce monde c’est la mort .»(11)
« Destin »,
« fatalité », « génie », tels sont les leitmotivs du récit, et les
modalités explicatives de ce parcours de vie tragique. Alors que
Semmelweis choisit résolument la vérité et la « vie » (p. 38), ses
ennemis « ont pactisé avec la Mort » (p. 53). Ce sont eux qui auront,
pour quelques décennies, gain de cause. Le biographe apparaît comme
celui qui rachète, après coup toutefois, le génie, et lui rend sa place.
Destouches se place d’emblée à la place de Semmelweis, comme celui qui
doit aussi « répondre point par point […] à nos détracteurs »
(« Préface » à l’édition de 1924, p. 24), et affronter l’hostilité de
ceux qui méprisent les découvertes médicales. Ainsi la biographie de
Semmelweis peut-elle se lire aussi comme un exemplum postural, à savoir un récit moral destiné à illustrer la dignité d’un comportement (littéraire, scientifique).
L’écrivain, autre découvreur maudit.
Une posture très voisine de celle attribuée à Semmelweis a cours chez Céline dès l’échec de Mort à crédit.
Il se présente comme un homme seul, méprisé comme le médecin hongrois
par le « troupeau passif » (p. 60). Cette posture devient peu à peu,
après 1936 et a fortiori après 1944 et le long procès pour collaboration avec les Nazis, celle de l’« intouchable » ou du « paria pourri »(12),
selon le lexique hindouiste. Isolé, rejeté pour avoir dit aux hommes
des vérités désagréables, il tire de cette mise à l’écart l’indice même
de sa valeur : la posture de l’écrivain maudit plonge ses racines très
anciennes dans un répertoire mythique que Pascal Brissette a décrit avec
précision (2005). Cette posture de bouc émissaire apparaît dès les
entretiens accordés lors de la sortie très controversée de Mort à crédit. Elle ne fait que de se diversifier et se radicaliser après la victoire alliée dès 1944 :
« Dans le fond, dit-il, j’ai une position idéale, solitaire, abandonné, brimé, que je fasse ce que je voudrai, je ne peux pas descendre plus bas. »(13)
« […] depuis 1932 j’ai encore aggravé mon cas, je suis devenu, en plus de violeur, traître, génocide, homme des neiges… l’homme dont il ne faut même pas parler !» (14)
Tout
se passe comme si Céline cherchait à occuper cette « position idéale »,
simultanément élective et tragique. Tout au long de sa trajectoire
d’écrivain, une telle posture se consolide peu à peu. Retraçons
rapidement la mise en scène du discours de vérité propre au
médecin-qui-écrit Céline : dès 1932, il se présente au public comme
médecin qui écrit, et reçoit les journalistes à son dispensaire, en
habit de praticien (Roussin 2005). Peu à peu s’impose, par contraste
avec les écrivains lettrés du champ littéraire, une posture de médecin
des pauvres, qui par son savoir scientifique et son expérience du
terrain le plus défavorisé, possède un savoir sur l’humain qui le rend
capable d’annoncer des vérités crues ou désagréables. Cette posture
d’autorité se double d’une image de soi comme d’un être accablé par sa
tâche, insomniaque, soucieux, et désespéré des hommes et de leurs maux.
Céline a souvent déclaré qu’il avait une « vocation » pour la médecine,
non pour la littérature.(15)
Comme le médecin, l’écrivain paie de son sang le travail de dissection
qui est le sien, afin de présenter une image des misères de l’homme.
L’autorité
à dire les vérités désagréables va de pair avec une conception de
l’histoire qui relève du sous-genre de « l’histoire secrète » : cette
catégorie désigne des ouvrages qui prétendent lever le voile sur un
événement pétrifié par sa version officielle, et dont l’historien nous
découvre soudain la face cachée. Dans Semmelweis, le biographe prétend par deux fois à l’histoire secrète :
« Si l’on pouvait écrire l’histoire mystérieuse des véritables événements humains, quel moment sensible, quel moment périlleux que ce voyage !» (p. 89)
« Mais on n’explique pas tout avec des faits, des idées et des mots. Il y a, en plus, tout ce qu’on ne sait pas et tout ce qu’on ne saura jamais. » (p. 101)
Sa révélation
tient à ce qu’il a compris les « puissances biologiques énormes »
(p. 111) qui gouvernent en fait le monde humain. Céline se présente
comme condamné à raconter le monde tel qu’il est, dans sa « nuit » et
sous sa face cachée ; et à demeurer ainsi incompris, voir haï de tous.
Désireux de dire aux humains quelques vérités cruelles sur eux-mêmes,
Ferdinand de Mort à crédit (1936) ne craint pas de provoquer ainsi leur haine à son égard :
« J’aime mieux raconter des histoires. J’en raconterai de telles qu’ils reviendront, exprès, pour me tuer, des quatre coins du monde. Alors ce sera fini et je serai bien content. »(16)
Céline ajoute en exergue à Mea culpa (décembre 1936) le même appel :
« Il me manque encore quelques haines. Je suis certain qu’elles existent. »(17)
L’image du « guérisseur souffrant »(18)
ainsi que divers autres motifs de la vertu évoquent la figure
christique de celui qui porte les maux du monde. Céline fut fasciné par
Semmelweis dont il disait encore en 1949 qu’il avait été son « idéal ».(19)
Il se passionnera pour la vie de Cavendish (« C’était un grand
homme !») que lui raconte Milton Hindus : ce savant anglais méconnu de
son vivant a vu ses cahiers reconnus de manière posthume.(20)
Cette posture d’incompris se radicalisera dès 1936 avec la série des
quatre pamphlets (1936, 1937, 1938, 1941), puis dans les romans du
réprouvé, après la seconde guerre mondiale.
Semmelweis
incarne aux yeux de Destouches-Céline la vérité bafouée et
l’« enthousiasme sacré » (p. 38) meurtris par la bassesse humaine.
« Saint homme » (21)
plus que « grand homme », d’ailleurs : sa grandeur n’ayant pas été
perçue, seule sa souffrance atteste en creux de l’aveuglement général.
Ce schème n’est autre que celui, religieux, du martyr (de la science, en
l’occurrence). Il reprend plusieurs éléments topiques de la geste du
créateur souffrant, telle qu’elle s’est déployée dans le grand public,
en France notamment, autour de Rimbaud et de Van Gogh (22) :
« Dans l’effroyable dénouement de ce martyre, dans la perfection même de cette coalition douloureuse, il ne peut pas y avoir que l’effet de nos petites volontés. »(23)
La
clausule de la thèse prend d’ailleurs la forme d’un bref paragraphe
consacré aux « martyrs » de la science (deux occurrences, p. 120) qui
résume l’ensemble de la visée pathétique de ce récit. Dans les dernières
pages, l’allusion se fait ouvertement christique :
« Il nous a tout donné, il s’est dépensé cent fois pour que nous soyons moins malheureux, plus vivants, et cent fois, les savants, les pouvoirs publics de son temps ont refusé avec une cruauté, une sottise inexpiable les dons admirables et bienfaisants de son génie. »(24)
À la lecture de Semmelweis,
on ne manquera pas de constater la banalité relative du discours
biographique mobilisé par Destouches, qui doit l’essentiel aux topiques
de la tradition et au discours social contemporain. Ce qui a retenu
notre attention dans la constitution d’une posture d’écrivain, c’est la
« relation biographique » qui se noue entre Destouches et Semmelweis. En
effet, la biographie est aussi le « récit d’un lien » entre le
biographe et son sujet, qui en dit long sur les deux termes du dialogue.(25)
C’est peu dire que Céline se projette, en écrivain incompris, dans la
figure de Semmelweis. Avant même d’entreprendre son œuvre de romancier,
il construit Semmelweis comme un personnage romanesque, à partir des échappées fictionnelles que l’on sait.
Ce
faisant, Céline arbore une posture qui gouverne l’ensemble de ses
interactions dans le champ littéraire et peut rendre compte de la
perception paranoïde qu’il se fait de la critique et du public : rançon
d’une solitude qui s’affirme implicitement, à travers son double
Semmelweis, comme une exception propre au « génie ». En transférant
éditorialement Semmelweis dans un corpus littéraire, en 1936,
Céline s’attribue la même prophétie auto-réalisatrice que celle qu’il a
faite pour son personnage : comme Semmelweis, je resterai incompris de
mon vivant et persécuté par les hommes.
Que
nous apprend enfin une telle étude de cas sur les rapports entre les
discours scientifique et littéraire ? Assurément, les règles de
formation des énoncés, dans cette thèse d’histoire de la médecine, en
1924, ne répondent pas à celles en vigueur au même moment dans la
communauté des historiens. L’histoire de la médecine telle que la
pratique Destouches, avec la complaisance de son jury, demeure un
exercice académique lié au genre mondain de l’éloge. La discipline n’a
pas encore formalisé ses méthodes et demeure coupée du courant
historiographique élaboré par l’histoire positiviste. Fruit de cette
histoire institutionnelle, la thèse de Destouches emprunte ainsi de
nombreux procédés à la rhétorique littéraire (genre épidictique,
héroïsation, narration épique ou pathétique). C’est pourquoi on peut
aujourd’hui la lire comme un roman. En outre, et à l’insu de
son auteur sans doute, le récit est travaillé par la logique du cliché,
c’est-à-dire par le passif et le passé figural de la langue, le dépôt
stratifié de ses usages et de ses formes, auquel tout « écrivant »
(Barthes) doit se mesurer. Pensons notamment à la manière dont
Semmelweis y incarne les figures du « génie » telles qu’elles se sont
constituées dès la Renaissance dans la tradition des vies d’artistes.
Jérôme MEIZOZ
Notes
1 Cet article reprend librement le propos d’un chapitre de notre ouvrage récent, Postures littéraires. Mises en scènes modernes de l’auteur, Genève, Slatkine Erudition, 2007.
2 Sur la notion de « réappropriation » en histoire culturelle, voir la leçon inaugurale de Rocher Chartier au Collège de France, Écouter les morts avec les yeux, Paris, Fayard, 2008.
3 Rappelons
que Louis Destouches a fait œuvre d’hygiéniste, depuis sa «Note» (1925)
sur la médecine chez Ford jusqu’à ses réflexions sur la santé des
chômeurs (1933) et sa participation, sous l’Occupation (notamment en mai
1941 puis février 1942), à des cercles médicaux eugénistes, où
s’expriment les thèses d’Alexis Carrel ou Georges Montandon. En mars
1942 enfin, Céline se rend à Berlin dans le cadre de la collaboration
médicale initiée avec les Nazis. Il y rencontre des médecins et des
dirigeants SS. Voir Philippe Roussin, op. cit., 2005, pp. 537-556.
4 Jean À. Ducourneau, Œuvres de L.-F. Céline, t. 1, Paris, Balland, 1966, pp. 573-621.
5 Philippe Sollers, «Naissance de Céline», in L.-F. Céline, Semmelweis, Gallimard, «L’Imaginaire» 1999, p. 10.
6 Je cite désormais Semmelweis dans le corps de cet article, par la simple référence à la page de l’édition de 1999.
7 Professeur à l’université de Budapest et éditeur des Œuvres complètes de Semmelweis, Tiberius de Györy envoie en 1925 à La presse médicale quelques
« Remarques » sur le texte de Destouches. Louant « notre grand martyr
médical hongrois » et le travail de Destouches, il corrige plusieurs
dates et chiffres (les taux d’infection) erronés. Il signale que
plusieurs éléments du récit sont de « pure imagination », ainsi la scène
de l’affichage des thèses sur les murs de la ville ou celle du scalpel
mortel. Voir ses « Remarques » citées dans L.-F. Céline, Semmelweis, Gallimard, «L’Imaginaire» 1999, p. 121.
8 L.-F. Céline, Romans I, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. 511.
9 Voir Jean-Claude Bonnet, Naissance du Panthéon. Essais sur le culte des grands hommes, Fayard, 1998, et Philippe Roussin, op.cit., 2005, p. 50.
10 Edgar Zilsel, Die Entstehung des Geniebegriffes (1926), trad. fr. de Michel Thévenaz, Le Génie. Histoire d’une notion de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Minuit, 1993.
11 L.-F. Céline, Romans I, op. cit., p. 200.
12 L.-F. Céline, lettre à Milton Hindus du 19 mars 1947, in Céline, Les Cahiers de L’Herne, 1972, p. 379.
13 L.-F. Céline, entretien avec André Parinaud, La Parisienne, janvier 1953, in Céline et l’actualité littéraire 1932-1957, Cahiers Céline 1, Gallimard, 1976, p. 154.
14 L.-F. Céline, Entretien avec André Brissaud, octobre 1954, in Céline et l’actualité littéraire 1932-1957, Cahiers Céline 1, Gallimard, 1976, p. 162.
15 L.-F. Céline cité par Milton Hindus, L. F. Céline tel que je l’ai vu, Paris, L’Herne, 1969, p. 45.
16 L.-F. Céline, Romans I, op. cit., p. 512.
17 L.-F. Céline, Mea culpa, in Céline et l’actualité 1933-1961, Cahiers Céline7, Gallimard, 1986, p. 30
18 Philippe Roussin, op. cit., 2005, p. 35.
19 L.-F. Céline, lettre à Albert Paraz du 11 septembre 1949, citée in Semmelweis et autres écrits médicaux, Cahiers Céline 3, Gallimard, 1977, p. 8.
20 Milton Hindus, L.-F. Céline tel que je l’ai vu, Paris, LHerne, 1969, p. 97.
21 Philippe Roussin, op. cit., 2005, p. 50.
22 Voir Nathalie Heinich. La Gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, Minuit, 1992.
23 L. Destouches, «Les Derniers jours de Semmelweis», La Presse médicale, 1925, cité dans Semmelweis, op. cit., p. 119.
24 L. Destouches, «Les Derniers jours de Semmelweis», La Presse médicale, 1925, cité dans Semmelweis, op. cit., p. 108.
25 Martine Boyer-Weinmann, La Relation biographique. Enjeux contemporains, Seyssel, Champ Vallon, 2005.
Illustration : Couverture de la thèse de Louis Destouches, Bibliothèque de l’Institut de médecine, Lausanne.
Nous remercions la rédaction du site EspaceTemps.net d'avoir bien voulu nous autoriser à reproduire ce texte.
Jérôme Meizoz
Jérôme Meizoz enseigne la littérature française à l’Unil (Lausanne) où il dirige la Formation doctorale interdisciplinaire (Lettres). Sociologue de la littérature (Ehess), il a publié divers essais dont L’Âge du roman parlant 1919-1939 (Droz, 2001, préface de P. Bourdieu), Le Gueux philosophe. Jean-Jacques Rousseau (Antipodes 2003), L’Œil sociologue et la littérature (Slatkine Erudition 2004) et récemment Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur (Saltkine Erudition 2007).